Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Elections turques : les ombres d’Atatürk
Dimanche prochain, les électeurs turcs se rendront à nouveau aux urnes pour des élections dont les enjeux intéressent directement l’Europe, le Moyen-Orient et bien sûr les destinées de la république de Turquie. Jusqu’aux derniers moments, on a pu craindre que les deux attentats du 22 juillet à Suruç et du 10 octobre à Ankara, qui ont fait respectivement 32 et 102 morts et un millier de blessés, entraineraient un report des élections, comme l’État islamique le prétendait. Voire leur annulation complète suivie de la proclamation de l’état d’urgence, comme ce fut le cas en 1960, en 1971 et surtout en 1980 lorsque l’armée, garante de la constitution, avait pris le pouvoir de force. Mais cette au profit de Recep Tayip Erdogan, le président de la république qui, lors des élections de juin, n’a pu obtenir ni la majorité des deux tiers indispensable à la création d’un régime présidentiel comme il le souhaitait, ni même une majorité suffisante pour former un gouvernement. Son parti, l’AKP, désigné comme « islamo-conservateur » en Europe, gère donc les affaires courantes avec à la tête du gouvernement Ahmet Davutoglu. Ce dernier, à la satisfaction des Européens, a garanti : « quelles que soient les circonstances, les élections auront lieu ».
Habitués à une information rapidement assimilable, nous avons du mal à ne pas reporter nos critères d’appréciation européens pour comprendre un pays qui nous est si proche. La Turquie est une des rares républiques laïques d’Europe, les femmes y ont le droit de vote depuis 1931 (quatorze ans avant les Françaises), l’économie y est ouverte, elle a enclenché un processus d’adhésion à l’Union européenne, ralentie contre son gré, elle est membre de l’OTAN et du G20… Et pourtant, la Turquie semble encore être une poudrière.
Fin d’empire. La biographie d’Atatürk, que l’historien Fabrice Monnier vient de publier aux éditions du CNRS, permet quelques éclairages qui aident à se repérer. Comme toutes les études consacrées au fondateur de la république de Turquie, elle s’interroge sans concession sur le jugement à porter sur un homme qui appartient à l’histoire mondiale. Elle fait une part plus grande au sort des "minorités" et insiste moins sur le personnage que la remarquable et très documentée biographie d’Alexandre Jevakhoff (dernière édition de 2004 chez Tallandier) et celle de Goerges Daniel (L’Harmattan, 2000). Elle apporte des éléments peu complaisants sur la vie de Mustafa Kemal, mais surtout sur « la naissance de la Turquie moderne », sous-titre choisi par Fabrice Monnier.
Ce dernier consacre la moitié de son ouvrage à la première guerre mondiale, précédée des guerres des Balkans, c’est-à-dire à une époque où l’immense majorité des Turcs comme les diplomaties occidentales, ignorent tout de l’existence de ce général né dans un milieu modeste. Comme pour rappeler que les circonstances ont fait l’homme.
Sans ce rappel minutieux, il est en effet difficile de comprendre la Turquie d’aujourd’hui. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’Empire Ottoman fait le tour de la Méditerranée, de la frontière serbe à la frontière algérienne, et s’étend jusqu’à Bagdad. Son sultan est l’autorité du monde sunnite. Les 60 années qui vont suivre seront celles du déclin, les territoires d’Afrique du nord passent sous protectorats britannique et français, qui prennent également pied au Moyen-Orient, l’Arabie saoudite et ses lieux saints font sédition, le Caucase passe sous influence russe. En 1911, un groupe nationaliste, les Jeunes Turcs, confisque les pouvoirs du sultan, s’attaque aux minorités grecques et arméniennes, pèse enfin pour une alliance avec l’empire germanique. Parmi eux, mais ne manifestant pas un nationalisme aussi aveugle, et très sceptique sur l’alliance avec l’Allemagne, le jeune Mustafa Kemal.
L’idée nationale. L’empire ottoman est composé de nombreuses nationalités, cultures, religions, qui coexistent loin de cette idée nationale qui, depuis 1838, bouleverse la politique européenne. En même temps que se constituent deux empires, français et britanniques, qui vont s’affronter aux désirs allemands de s’élever au même niveau. Mais la Sublime Porte a manqué la révolution industrielle, son déclin économique précède le déclin du système politique. Mustafa Kemal en aura le premier l’intuition, Atatürk aura la détermination de pousser le mouvement jusqu’au bout, sans insulter les circonstances.
Il saura d’abord emporter une des rares batailles gagnées par l’Empire dans la guerre, au détroit des Dardanelles. Il évitera ensuite la dérive des Jeunes Turcs, notamment coupable du génocide arménien pendant lequel, confirme Fabrice Monnier, il ne jouera aucun rôle actif, « spectateur impuissant et quelque peu indifférent ». Il saisira l’intérêt de négocier avec les alliés. Puis, la guerre perdue, montrera l’intransigeance d’un chef lorsque la Grèce, menée par le très habile et très autoritaire Vénizélos, prétendra dépecer l’Empire de sa rive occidentale et des ports de la Mer Noire avec l’accord de Lloyd Georges, Clémenceau et Wilson.
En cette époque où se constituent, dans l’euphorie de la victoire ou dans le cataclysme de la défaite, les nations modernes, Mustafa Kemal saura diriger ce qu’il reste d’armée et mobiliser le peuple pour conserver une terre ottomane ramenée à des territoires majoritairement peuplés de Turcs. Alors que le traité de Sèvres prévoit, en 1920, un dépeçage inédit de l’Empire dont la majeure partie reviendrait aux Grecs, Italiens, Arméniens, Français et Britanniques (par la Syrie et l'Irak). Des finances sous séquelles, une occupation militaire et l’internationalisation des détroits sont également au programme.
Comme de nombreux autres leaders nationaux, Mustafa Kemal refusera l’anéantissement d’une culture et d’un pays glorieux, appellera à la résistance nationale, gagnera contre les vainqueurs la conservation d’un État, même privé de la Syrie, la Mésopotamie et l’Arabie. Mais il va faire plus, bien plus.
La république laïque. Leur chef Enver Pacha en tête, les Jeunes Turcs déconsidérés se réfugient en Allemagne. C’est l’occasion, pense le sultan Mehmet VI, de reprendre le pouvoir perdu en 1911. Il est clair, dès cette époque, que Mustafa Kemal ne courtise le sultan que dans l’intention de disposer des meilleurs moyens pour accomplir son destin qui bientôt va se marier à celui de la nation. L’occupation du « territoire national » par les armées étrangères va lui fournir l’occasion inespérée de prendre la tête du principal corps d’armée. Sitôt des appuis suffisants assurés auprès des officiers, il se lance. Le 22 juin 1919, il prononce l’appel d’Amasya . « C’est le premier acte de la révolution turque » note justement Fabrice Monnier qui poursuit : « il condamne violemment la politique gouvernementale et préconise la réunion en Anatolie d’un congrès national ». Ce sera fait à Sivas avec des représentants turcs, kurdes, lazes et circassiens.
Dès lors, Mustafa Kemal se comporte comme le « sauveur de la patrie », qui compte plus sur le peuple, notamment ses notables et son armée, que sur les finesses des négociations avec alliés pour préserver le pays. Il s’exprime « au nom de la nation » alors qu’il ne fait pas même partie du gouvernement du sultan. L’Anatolie est sienne. Il fait d’Ankara, petite ville de 15 000 habitants, sa capitale d’où partira la reconquête. Sa détermination sera inébranlable, ses idées arrêtées, faire de ce pays une république laïque. « On peut aisément comprendre le caractère d’un gouvernement qui repose sur le principe de la souveraineté populaire : c’est la République » dira-t-il. Le Sultan tente de mobiliser tous les traditionalistes, prononce une fetva contre lui, le fait condamner à mort, en appelle aux Alliés qui confie la mission au responsable de la partition du pays : le Grec Venizélos. Kemal, jouant de l'horreur d'une nouvelle guerre qu'ont désormais les peuples européens, va les vaincre grâce à la résistance nationale, puis non seulement priver le sultan, qui commet l’erreur de signer le traité de Sèvres, de son pouvoir politique, mais également, ce que personne n’attendait, du califat, c’est-à-dire son pouvoir religieux. La république est proclamée en 1923.
Les questions qui font polémique. Sur celui qui deviendra Atatürk (Turc-père) sur décision de l’assemblée nationale, les analyses aujourd’hui encore divergent. Notamment sur son autoritarisme proche des dictateurs qui s’avancent entre les deux guerres, d’Hitler à Staline en passant par Mussolini qu'il déteste. Le général a connu la grande guerre et ses millions de morts, les centaines de vie perdues quotidiennement par les Allemands, les Britanniques ou les Français, à l’assaut d’une colline qui sera reperdue le lendemain. La vie n’a alors pas si grande valeur et, pour tous les dirigeants européens, russes et turcs, l’objectif politique de construction nationale passe avant l’intégrité de l’individu. De fait, la toute jeune république n'hésitera à réprimer dans le sang toute rébellion, des forces traditionalistes comme des "minorités".
La question du parti unique est d’importance. Fabrice Monnier n'accrédite pas la thèse d'Alexandre Jevakhoff, selon laquelle Mustafa Kemal défendra d’abord l’idée qu’une démocratie sans opposition n’en est pas vraiment une. Puis se ralliera à l’opinion de ses seconds, notamment son compagnon de la première heure et futur successeur Inönü, qui n’entendent pas s’encombrer d’une opposition et penchent pour une démocratie populaire plus que libérale. Ils ont, il est vrai, la lourde tâche de reconstruire un pays ruiné, sans moyens de communication moderne et sans industries. Et surtout, volonté farouche de Mustafa Kemal, de faire vivre la république à pas de charge, assurer la paix dans des frontières intangibles et sans expansionnisme, changer l’alphabet arabe contre l’alphabet latin (en 1928 la mesure est proclamée et, dans les trois mois qui suivent, tous les Turcs retournent à l’école), adopter le calendrier grégorien, émanciper les femmes en leur octroyant le droit de vote et en interdisant la polygamie, proclamer l’instruction laïque, mixte et obligatoire notamment pour les filles dans un pays où 90% de la population est analphabète, changer jusqu’à la mode vestimentaire en obligeant les hommes à porter chapeau à l’occidentale et en suggérant fortement aux femmes d'abandonner le voile. Les milieux conservateurs et traditionalistes avaleront les couleuvres tant l’aura du « Gazi » est forte et leur passé taché par leur alliance avec les occupants. Cela n’est d’ailleurs pas sans rappeler le général De Gaulle, sa façon d’imposer silence à la droite pétainiste et à la gauche de la IVe république, son pragmatisme pour servir la nation, son sens de l’avenir pour la décolonisation, sa farouche volonté d’indépendance nationale. Et la façon aussi dont, en Europe aujourd’hui, cette droite traditionaliste ressort de l’ombre.
La question kurde est aujourd’hui également reprochée à Atatürk qui a placé l’idée de la république une et laïque au dessus de tout, il n’entend pas « fédéraliser » le pays, mais au contraire turquiser les Kurdes qui se voient privés de leur langue et de leurs coutumes ancestrales. Là encore, il n'agira pas avec plus de mansuétude que les Révolutionnaires français vis-à-vis des régionalismes, ni moins d'indifférence à l'autonomie kurde que les Britanniques qui annexent à la même époque la région de Mossoul à l'Irak ou les Français qui "protègent" la Syrie.
Ces successeurs n’auront plus l’excuse de la reconquête nationale, de la construction de la république, de l’émancipation des femmes, de l’alphabétisation du peuple. Après avoir été écarté par Atatürk un an avant sa mort, Inönü prend le pouvoir, adoucit la laïcisation, s’enfonce dans un système étatique avec une armée garante de la constitution mais aussi principale force économique et sociale. Les compagnons d'Atatürk, divisés entre deux partis, gouverneront la vie publique jusqu’aux années 80, avant la libéralisation conduite là encore à marche forcée par un nouveau parti islamiste, celui d'Erdogan. Qui a ouvert le pays et se rêve en héritier d'Atatürk, en moins républicain et moins laïque tout de même. Mais qui, comme tout homme politique n’acceptant pas l’alternance et n’y étant pas obligé par une opposition trop faible, peut le refermer demain.
Atatürk, naissance de la Turquie moderne de Fabrice Monnier. CNRS Éditions, 346 pages, 22,50 €.

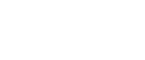 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
